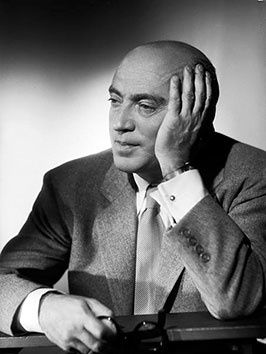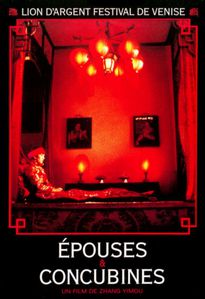Difficile de brosser en quelques lignes le portrait d'un homme qui est encore en pleine activité créatrice, sinon de l'écouter parler de lui-même, de ses projets, de ses aspirations, de ses doutes, de ses enthousiasmes, de ses craintes aussi. Comment se voit-il, comment évolue-t-il ? Ce qui est intéressant d'ailleurs avec les films de David Lynch, c'est que contrairement aux Ch'tis, ils ne font pas l'unanimité. Alors comment vit-il ces contestations permanentes ? Certains, après avoir vu "Inland Empire" (2006) se sont inquiétés du taux de drogue que ce dernier avait dû absorber pour avoir une semblable écriture cinématographique ; des cyniques ont proposé que ses oeuvres soient sponsorisées par l'Institut national du sommeil et de la vigilance, alors que les inconditionnels - et ils sont tout de même nombreux - ne manquent pas de tomber en pâmoison à la simple évocation du maître. C'est dire à quel point ce cinéaste est contesté. Du surréaliste "Eraserhead" (1978), son premier long métrage en noir et blanc oppressant, à l'envoûtant "Lost Highway" (1997) ou à l'incantatoire "Mulholland Drive" (2001), en passant par ses productions musicales "Blue Bob" (2002) et "Elephant Man" (1980) où il se confirme comme le peintre des marginaux et des "monstres", David Lynch ne cesse de surprendre, de dérouter, fasciner et troubler par son oeuvre fantasmée, volontiers construite sur des énigme et qui donnent au moins une idée de la subtilité et de la sensibilité de leur auteur. Et il déroute d'autant plus qu'il privilégie la force de mystère et l'abstraction et montre peu d'empressement dès qu'il s'agit de répondre aux interviews et d'apporter quelques éclaircissements sur son travail.
Aussi est-il impératif de l'écouter lorsqu'exceptionnellement il lève un coin du voile à travers un livre qui oscille entre autobiographie et recueil de pensées : Mon histoire vraie aux éditions Sonatine. De cet ouvrage, il ressort que l'auteur de Twin Peaks est un homme (presque) normal, certainement peu banal qui a étudié aux Beaux-Arts et est resté marqué par cette formation. La preuve en est que, malgré ses oeuvres hantées de meurtres et peuplées de schizophrènes délirants, Lynch ne se considère ni comme un psychopathe, ni comme un maniaco-dépressif. Il est équilibré, écrit-il, ne se drogue que de café et reste émerveillé par les innombrables surprises que la vie ne cesse de nous réserver. S'il nous conte, à travers ses longs métrages, des histoires sombres, c'est simplement parce qu'elles reflètent notre monde qui, contrairement à l'enfer, n'est pas toujours pavé de bonnes intentions...D'ailleurs lui-même pratique assidûment la méditation transcendantale, afin de conserver sa sérénité et sa créativité. En définitive, il n'est jamais qu'un observateur sans concession d'un monde passionnant mais un peu fou. On apprend aussi, en poursuivant la lecture de ce livre, que ses idées poétiques et dérangeantes ne lui sont pas inspirées par ses cauchemars mais, et je le cite : "qu'elles sont comme des poissons. Les petits sont proches de la surface de l'eau, et les gros...plus beaux, plus purs - nagent en profondeur. Plus votre conscience s'élargit, plus vous plongez loin et trouvez de gros poissons". Vous l'aurez compris, la méditation transcendantale a encore frappé. "Moi" - poursuit-il - "j'utilise cette technique pour attraper des poissons-idées de cinéma, mais il existe toutes sortes de poissons-idées : pour le design, l'informatique, le commerce. Je n'ai pratiquement jamais tiré d'idées de mes rêves. Les poissons, pensez aux poissons". Nous voilà avertis et désillusionnés, tant nous aspirions à un créateur un peu plus déjanté. Il n'en est rien. Remisons notre mythe au grenier. Par contre Lynch admet être un rock'n'roller amoureux de la musique, mais pas un vrai musicien : "Je tiens avant tout à être libre de faire un film comme je l'entends, de A à Z. Si d'autres personnes s'en mêlent, le projet n'est pas cohérent et devient un échec, comme de fut le cas pour Dune." Lui-même est attristé par les formules qui régissent le cinéma aujourd'hui : "Si vous voulez faire quelque chose, faites-le ! Conservez votre propre voix, et cassez les codes ! Il n'y a pas de règles en art."
Contrairement à ce qui avait été dit ici et là, David Lynch ne travaille pas à une suite de "Twin Peaks", ni à une adaptation de "La métamorphose" de Kafka ou du "Lolita" de Nabokov, même si ces derniers projets lui trottent dans la tête. Pour le moment, il se concentre sur la peinture, de nouvelles photos et sa musique. Ainsi que sur un documentaire de la tournée mondiale qu'il a effectuée pour promouvoir la méditation transcendantale. Quant à sa prochaine réalisation, soyons patients, Lynch n'est pas homme à se séparer longtemps de sa caméra. Grand créateur de sortilèges visuels et sonores, il réussit toujours à fasciner son public grâce à une oeuvre fluide et souvent émouvante, avec une imagerie à double face qui ne dédaigne pas de débusquer les nuances de l'ombre et renvoie en permanence à une réflexion sur le cinéma et ses possibles et l'exhibition des apparences. Lynch a toujours enchanté par son sens du mystère.
Pour lire les articles consacrés aux Réalisateurs, cliquer sur le titre :
LISTE DES ARTICLES - REALISATEURS du 7e ART


/image%2F0925611%2F20220131%2Fob_3b07dc_1888187.jpg)
/image%2F0925611%2F20220131%2Fob_3e6e60_42ba513c42a0fd6558aa44b1de658140-15078.jpg)


/image%2F0925611%2F20210411%2Fob_f49231_18942746-jpg-r-1280-720-f-jpg-q-x-xxyx.jpg)
/image%2F0925611%2F20220517%2Fob_98d358_images.jpg)
/image%2F0925611%2F20220517%2Fob_a42e32_telechargement.jpg)
/image%2F0925611%2F20210411%2Fob_0a496b_136406.jpg)

/image%2F0925611%2F20210410%2Fob_652cc3_18445289-jpg-r-1280-720-f-jpg-q-x-xxyx.jpg)


/image%2F0925611%2F20210410%2Fob_f87c12_telechargement.jpg)





/image%2F0925611%2F20210410%2Fob_62dd95_21006979-20130519125205056.jpg)