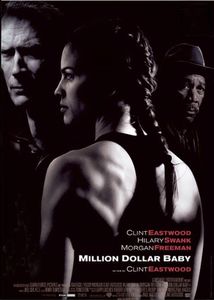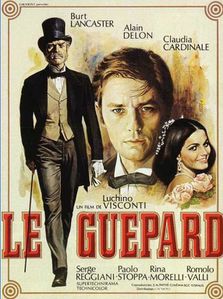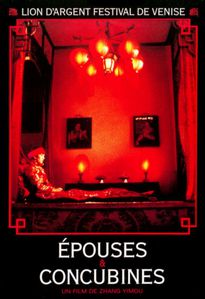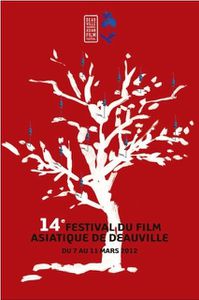Les Enfants du Paradis, film de Marcel CARNE, tourné en 1943 sur un scénario de Jacques PREVERT, réunissait tous les ingrédients pour être une oeuvre phare qui compterait dans l'histoire du cinéma français. Inspiré de la vie de Debureau, le script fort bien troussé est servi par une distribution de premier ordre, dont l'inoubliable Arletty et Jean-Louis Barrault dans le rôle émouvant du mime Baptiste. Une méditation sur l'impossibilité de l'amour et du bonheur dans un Paris qui semble aussi fantomatique que les personnages. Un monde en apnée, un carnaval triste envahi de masques et de funambules qui vous laisse longtemps dans l'esprit un goût fatal de cynisme et de poésie. Bien que complétement décalé de la réalité d'aujourd'hui, on ne se lasse pas de le revoir, ce qui prouve, si besoin est, que l'art a le droit de se moquer des modes. Il est vrai que cette fresque romanesque et épique composée de deux parties : Le boulevard du crime et l'homme blanc - a ceci de particulier, de ne pas mettre en scène une reconstitution historique de l'époque avec l'évocation d'événements représentatifs, faits d'armes ou catastrophes, mais de favoriser la progression de l'intrigue par une suite de scènes intimistes, bâtissant son scénario sur la noblesse et la dérision des sentiments amoureux, la passion forcenée, au point d'en faire une épopée si originale qu'à ce jour on ne lui connait pas d'équivalent dans le 7e Art, sauf, dans une certaine mesure, chez Renoir qui témoignera avec Le carrosse d'or d'une préoccupation assez voisine. D'entrée de jeu, nous savons, en voyant le générique défiler sur un rideau de scène et en entendant frapper les trois coups, que le récit qu'on nous propose répond aux critères de la stylisation théâtrale. Les personnages, qui animent l'action, affichent une identité volontairement théâtrale, que ce soit Frédérik, Lacenaire, Baptiste ou le comte de Montray. Héroïne romantique, Garance, la femme autour de laquelle tournent les hommes au point que l'existence de chacun s'épanouira en fonction d'elle ; oui, cette héroïne parée des prestiges de la mélancolie n'en est pas moins moderne dans son souci de défier sereinement les préjugés.
Hommage au spectacle, Les Enfants du paradis magnifie les hommes de théâtre qui ne sont eux-mêmes qu'en se mettant en scène. Baptiste, lorsqu'il rejoint Garance, commet un acte irréversible, car la pantomine exige que Baptiste soit malade d'amour pour la plus grande gloire de l'art et de l'artiste. Frédérik, quant à lui, a besoin de ressentir la morsure de la jalousie que lui inflige Garance, afin d'endosser le rôle d'Othello et l'interpréter avec la gravité douloureuse qui sied au personnage. C'est ainsi que le théâtre a raison de tout, au point que la dernière image laisse la marée des masques submerger l'écran. Qui a aimé qui et comment ? Certes Baptiste a aimé la simple jeune fille qui lui a tendu une fleur et est devenu la dame de ses songes. Certes Frédérik a vénéré Desdémone qui suscitait sa passion ; Lacenaire, la seule femme qu'il pouvait considérer comme son égale, parce qu'aussi libre que lui ; le comte de Montray, l'incarnation de la beauté, c'est-à-dire davantage la statue qu'il avait vue sur la scène des Funambules que la femme qu'il avait épousée. Ne lui avait-il pas glissé à l'oreille que la beauté est une exception, une insulte au monde qui est laid. "Rarement les hommes aiment la beauté - avait-il ajouté, ils la pourchassent pour ne plus en entendre parler, pour l'effacer, l'oublier..." Mais Garance, qui aime-t-elle ? Le film laisse planer le mystère, garde secret le coeur de cette femme, représentation idéale et souveraine de la liberté.
En procédant par chapitres, comme dans un roman, plutôt que par actes, Carné et Prévert ont réussi un film aussi passionné que contemplatif, aussi incarné qu'idéalisé, aussi lucide que désabusé. D'où le charme aigu qui s'en dégage, la séduction qu'il exerce soixante ans après sa sortie, alors que la plupart des films "à costumes" apparaissent, de nos jours, comme des pièces de musée passablement défraîchies. Nous sommes encore frappés de l'audace de certaines compositions qui ont prévalu dans une mise en scène qui a, néanmoins, beaucoup sacrifié à la beauté plastique, mais on sait combien il est difficile de faire de l'art avec l'art. Alors que nombreux sont ceux qui s'y sont cassés le nez, Carné et Prévert ont su en exalter la quintessence, grâce à l'intelligence et la sensibilité du scénario, du découpage des scènes, des dialogues, des décors, de la musique et de l'interprétation de comédiens de première grandeur. On n'oubliera jamais plus le grincement grêle des manèges, le regard éperdu de Baptiste, le tumulte qui anime le boulevard du Crime, Garance costumée en muse de la poésie et la pantomime que nous propose le fameux "chand d'habits". Pour toutes ces raisons, l'intrigue amoureuse construite autour d'une Arletty magnifique en déesse de l'amour, inspirant un désir fou à un mime enfariné, à un anar glacé (Marcel Herrand) et à un dragueur irrévérencieux (Pierre Brasseur), scènes vécues sur fond de décor populaire, est une des plus grandes réussites du cinéma français. Un chef-d'oeuvre absolu.
Pour consulter la liste complète des articles de la rubrique CINEMA FRANCAIS, dont La règle du jeu, cliquer sur le lien ci-dessous :
LISTE DES FILMS DU CINEMA FRANCAIS



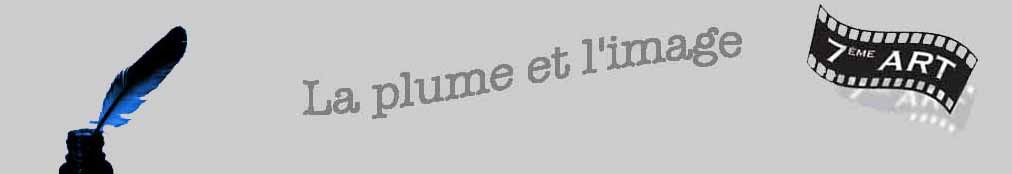


/image%2F0925611%2F20210409%2Fob_985775_18798055.jpg)

/image%2F0925611%2F20210501%2Fob_3067e1_file-13-25.jpg)
/image%2F0925611%2F20210501%2Fob_bf09e2_visconti68.jpg)
/image%2F0925611%2F20210409%2Fob_0e74a8_18460574.jpg)

/image%2F0925611%2F20210409%2Fob_b3214c_18792479.jpg)

/image%2F0925611%2F20210419%2Fob_59ff21_aff.jpg)


/image%2F0925611%2F20210409%2Fob_518185_206206.jpg)





/image%2F0925611%2F20210423%2Fob_630c7e_3152707.jpg)

/image%2F0925611%2F20210410%2Fob_513cab_21024402-20130805124450759.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F63%2F85%2F35%2F18720763.jpg)
/image%2F0925611%2F20230707%2Fob_07777f_fellini-federico.jpg)