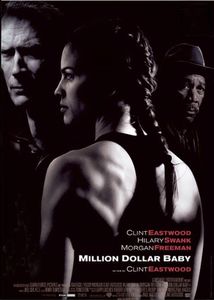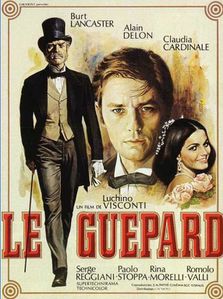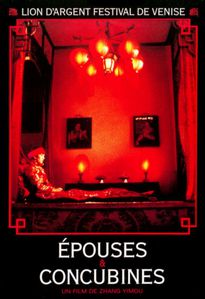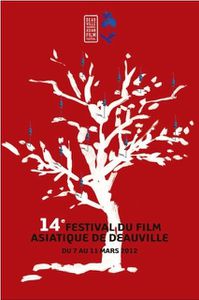Plus âgé que Truffaut et Godard auxquels on le rattache volontiers, Eric Rohmer, de son vrai nom Maurice Schérer, est né à Nancy en 1920. Il débute sa carrière, au lendemain de la guerre, dans la critique de cinéma, écrivant dans La revue du cinéma, Les temps modernes, La gazette du cinéma et Les cahiers du cinéma dont il sera le rédacteur en chef à la mort d'André Bazin de 1958 à 1963. Son oeuvre critique, réunie en un volume sous le titre" Le goût de la beauté", est l'une de celle qui a eu le plus d'influence pour définir la pensée cinématographique à partir des années 50. Plus profond et moins tapageur que Godard, il eut à coeur de défendre Renoir et Rossellini alors très attaqués, et sut se battre pour l'émergence d'un cinéma méritant pleinement sa place de 7e Art. Il commença par réaliser des courts métrages dont "Véronique et son cancre" en 1958, où l'on trouve déjà l'essentiel des qualités d'humour, d'intelligence, d'ironie qui le distingueront et auquel s'ajoute un savoir-faire indiscutable. Ce fut en 1963 qu'il signe son premier long métrage "Le signe du lion", produit par son ami Chabrol. Ce film n'eut hélas aucun succès auprès du public, d'autant qu'il avait été tourné avec des acteurs peu connus ; néanmoins quelques connaisseurs le considéreront d'emblée comme une promesse d'avenir. Ennemi de la provocation et de la facilité, Rohmer amorce avec ce premier film une démarche personnelle, faite de rigueur et d'un souci évident d'esthétique, ce qui n'était pas toujours le fait des débutants de l'époque. Cet échec l'obligea à travailler un certain temps pour la télévision. Après cette période, où il se consacre à des films scolaires et, dans un ensemble d'émissions sur les cinéastes de notre temps, à une étude sur Carl Dreyer, il reprend le long métrage avec un projet ambitieux, celui des "Six contes moraux".
C'est avec "La collectionneuse" en 1967 que l'on découvre enfin l'ampleur de son talent, sa qualité d'écriture, la beauté de ses images, avant qu'il ne s'impose de façon éclatante avec ce que je considère comme son chef-d'oeuvre : "Ma nuit chez Maud". Ce film ralliera à Rohmer les derniers hésitants, désorientés un moment par la diversité brouillonne de ses propos. Avec "Ma nuit chez Maud", il impose un ton, un dépouillement quasi janséniste. Bien qu'appartenant à la série des "Six contes moraux", ce film s'en détache par sa gravité particulière. Elle réside dans le sujet lui-même et un grand nombre de dialogues. Bien que non dénué d'humour et même de drôlerie, principalement lors du tête à tête embarrassé de Maud et du narrateur, le film, de par sa structure, relève davantage du récit classique que de la comédie et ceci davantage encore qu'il est raconté à la première personne et au présent, ce qui est une prouesse qui n'avait jamais été tentée à l'écran et démontre l'audace et l'esprit d'innovation du cinéaste. C'est ainsi dans une sorte de présent-passé que se déroule le film et l'effet de décalage, qui en résulte, contribue à créer un climat d'étrangeté ; de même que l'histoire s'accompagne de son propre commentaire, initiative supplémentaire de la part de Rohmer. Les héros sont des intellectuels et, d'ailleurs, s'expriment comme tels. Les entretiens sur Pascal et son défi, sur la probabilité et la grâce sont ceux d'un auteur à part entière. Rohmer n'élude aucune difficulté et va jusqu'au bout de sa démonstration comme un artiste complet, associant la valeur du texte à celle de l'image, sans être jamais ni ennuyeux, ni pédant. Pour une fois, un cinéaste intellectuel ose faire un film qui lui ressemble et l'on découvre que le résultat est tout simplement passionnant. En cela, Rohmer se rappoche d'un Renoir et d'un Rossellini qui avaient tenté l'expérience sans aller aussi loin, car Ma nuit chez Maud réussit une synthèse encore plus aboutie que celle envisagée dans Le Fleuve (195O) et Le voyage en Italie (1954). Comme chez ces deux cinéastes auxquels il se rallie avec cette oeuvre, Rohmer soigne sa mise en scène qui, à force de maîtrise, devient transparente et toute entière consacrée au contenu, car ce qui compte est l'écriture serrée du scénario, la pertinence des dialogues et le caractère des personnages. A ces derniers, le cinéaste confère un degré d'existence rare, que le choix des interprètes porte à un paroxysme d'excellence. Jamais Trintignant n'a été meilleur que dans le rôle de l'ingénieur catholique qui cache ses tourments sous une assurance factice, plus convaincante Marie-Christine Barrault dont le visage rayonnant dissimule ses secrets et ses ombre, plus séduisante Françoise Fabian en femme épanouie, maîtresse d'elle-même et d'une classe folle et, plus efficace et horripilant un Antoine Vitez en parfait intellectuel, dialecticien agile et passablement verbeux. Film très "milieu du siècle" comme Rohmer le dit lui-même, qui utilise pleinement les ressources du noir et blanc, "Ma nuit chez Maud" illustre à la perfection le monde poétique de son auteur. " Quand je filme - a confié Rohmer lors d'un entretien avec Les Cahiers du cinéma - je réfléchis sur l'histoire, sur le sujet, sur la façon d'être des personnages. Mais la technique du cinéma, les moyens employés me sont dictés par le désir de montrer quelque chose." Sur ce plan, il a parfaitement atteint son but, réalisant en un seul film une impressionnante synthèse sur les questions essentielles qui se posent à l'homme d'aujourd'hui. Mauriac n'est pas si loin.
Pour prendre connaissance des articles consacrés à Eric Rohmer et Jean-Louis Trintignant, cliquer sur leurs titres :
ERIC ROHMER OU UN CINEMA DE LA PAROLE JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
Et pour consulter la liste complète des articles de la rubrique CINEMA FRANCAIS, dont "Le genou de Claire", cliquer sur le lien ci-dessous :
LISTE DES FILMS DU CINEMA FRANCAIS

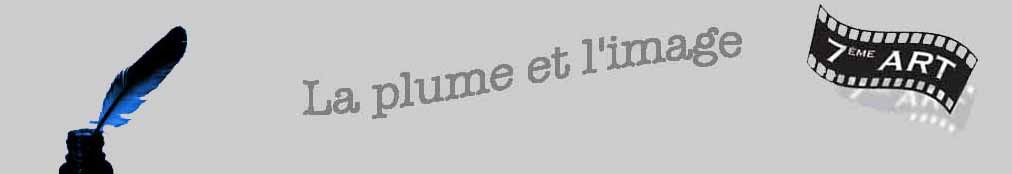
/image%2F0925611%2F20220114%2Fob_6045af_image-0925611-20210326-ob-5a1f97-unnam.jpg)
/image%2F0925611%2F20210824%2Fob_ef7320_2fba45ca-07aa-64a1-4ff7-d1f5228c04fb.jpg)