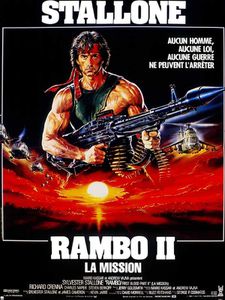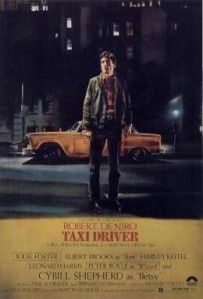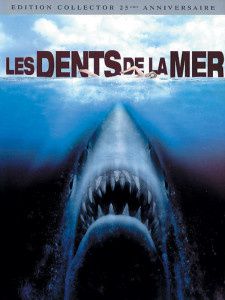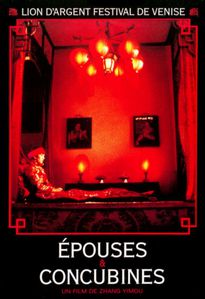En 1950, un danger se profile qui peut miner l'essor du cinéma américain : l'envahissement du petit écran dans les foyers, soit cette lucarne qui a le pouvoir de retenir chez lui le spectateur et de le dissuader de se rendre dans les salles obscures. Peu importe que les images télévisées soient encore en noir et blanc, les écrans petits et les émissions proposées de piètre qualité, le cinéma est en danger et les professionnels sont tenus de réagir au plus vite, s'ils ne veulent pas que le 7e Art périclite inexorablement. C'est alors que les exploitants des salles lancent une campagne d'affiches où l'on peut lire ceci : " Prenez votre auto, dînez dehors, allez voir un bon film!" De son côté, l'industrie cinématographique multiplie les innovations et se lance un défi : au petit écran, elle oppose ... l'écran panoramique, les couleurs de plus en plus travaillées et des essais de films en 3D (en 1954 la Warner en sortira trois). Quant aux producteurs, ils se ressaisissent à leur tour en innovant dans des superproductions que le petit écran serait bien peine de concurrencer, instituant un cinéma spectaculaire sensé asseoir à tout jamais sa suprématie. Ce mouvement hollywoodien vers un cinéma qui suppose des moyens colossaux sera incarné par Cécil B. De Mille qui, dès 1918, avait appliqué le mot d'ordre d'Adolph Zukor : "Tournez des pièces prodigieuses avec des acteurs de premier ordre." En 1956, De Mille décide de tourner Les dix commandements avec Charlton Heston, Yul Brynner et Anne Baxter qui s'avèrera son film-testament ; il y multipliera les prouesses de mise en scène en dirigeant 15 000 figurants dans les péplums bibliques dont on sait déjà qu'ils enthousiasment le public (il y avait eu en 1951 le Quo Vadis de Mervyn LeRoy). La Rome antique et l'ancienne Egypte sont des sujets porteurs qui permettent des images grandioses et des reconstitutions flatteuses à l'oeil du spectateur, si bien qu'après Les dix commandements, ce sera le Ben-Hur de William Wyler, superproduction des superproductions qui recueillera tous les superlatifs : son coût de 15 millions de dollars, ses milliers de figurants, ses quatre mois de répétition, sa séquence de course de chars qui a nécessité un réalisateur spécifique, ses trois mois de tournage, sa longueur exceptionnelle de trois heures et demie, sans compter qu'au final le film récoltera neuf Oscars et se placera au premier rang du box-office aux côtés de Autant en emporte le vent.

A sa suite, mais sans le surpasser, il y aura Le tour du monde en 80 jours de Michael Anderson, Barabbas de R. Fleisher et la magnifique fresque historique de David Lean Lawrence d'Arabie qui fera souffler dans les salles obscures les vents du désert. Production anglo-américaine, le scénario se conformait au livre de Thomas E. Lawrence lui-même "Les sept piliers de la sagesse", où l'on voit le colonel britannique tenter de promouvoir auprès des représentants du Royaume-Uni et de la France l'indépendance des pays arabes. Trois ans plus tard, David Lean signera, avec le même scénariste Robert Bolt, une adaptation très réussie du roman de Boris Pasternak : Docteur Jivago. Pourtant rien n'y fera et le nombre de spectateurs continuera de chuter de façon vertigineuse. Si en 1955, on recensait chaque semaine 50 millions de spectateurs aux Etats-Unis, le nombre ne sera plus que de 30 cinq ans plus tard. L'inflation des superproductions n'est pas parvenue à gagner la guerre contre le petit écran. Néanmoins, de ce combat perdu, il nous reste quelques scènes d'anthologie inoubliables qui ont nourri notre imaginaire et contribué à parfaire à jamais la légende du 7e Art.
Pour lire les articles relatifs à cet article, cliquer sur leurs titres :
LAWRENCE d'ARABIE, DE LA REALITE A LA LEGENDE
DAVID LEAN, L'IMAGIER PRESTIGIEUX













/image%2F0925611%2F20140603%2Fob_273916_telechargement-1.jpg)
/image%2F0925611%2F20140603%2Fob_84ab1a_telechargement-4.jpg)
/image%2F0925611%2F20140603%2Fob_78c6e0_telechargement-5.jpg)
/image%2F0925611%2F20210511%2Fob_2e2966_mannequin-bella-hadid-tapis-rouge-71e.jpg)


/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F62%2F48%2F39%2F18645991.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F60%2F09%2F04%2F18608621.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F36%2F14%2F42%2F18455734.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F36%2F01%2F56%2F18445370.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F36%2F37%2F72%2F18478426.jpg)
/image%2F0925611%2F20201127%2Fob_469cbe_images.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F63%2F15%2F65%2F18708574.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F69%2F61%2F94%2F19069709.jpg)
/image%2F0925611%2F20201127%2Fob_0b28eb_c9a9ceb-bte08-health-coronavirus-paris.jpg)