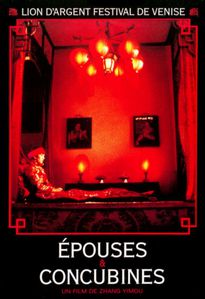Maurice Pialat, né en 1925, rêvait depuis de longues années de tourner une vie de Vincent Van Gogh, ce qui avait été fait bien des fois avant lui, mais d'une façon qui ne semblait pas correspondre à la vision personnelle qu'il avait du peintre. Ancien élève des Arts décoratifs, peintre à ses heures (c'est sa main qui double celle de Jacques Dutronc dans le film), Pialat réalise enfin son projet en 1991, en adoptant la voie qui lui sied le mieux : celle du dépouillement et de la rigueur, à l'égard d'un personnage qui disait " chercher quelque chose de paisible et de plaisant, réaliste et pourtant peint avec émotion, quelque chose de bref, de synthétique, de simplifié et de concentré, consolant comme une musique".
Le cinéaste relate dans son film les derniers jours de Van Gogh à Auvers-sur-Oise, où il est recueilli par le docteur Paul Gachet, à qui l'a recommandé son frère Théo. Il a alors 37 ans et mène une existence misérable qui a durement endommagé sa santé. Son tempérament ardent l'a toujours entraîné à fréquenter les prostituées, à boire plus qu'il ne faudrait en compagnie de pochards, à tenir tête à son frère, si dévoué et admirable, au seul prétexte qu'il était trop bourgeois à son gré. Il va même trouver le moyen d'embarquer dans cette débauche la fille de son hôte, la jeune et jolie Marguerite (Alexandra London). Mais malgré son goût des filles, de la boisson, cet être en perdition n'a qu'une seule vraie passion : la peinture. Il s'y consume dans la lumière poudrée de l'Ile-de-France, jusqu'à ce qu'un jour de juillet 1890, au comble du désespoir, il se tire une balle dans le ventre.
Pour le centième anniversaire de cette mort tragique, on comprend qu'un cinéaste comme Pialat ait eu envie, en 1990, de nous redire l'homme plus encore que le génie dans ses doutes et sa misère, ceux d'un créateur pris au piège de sa création, d'un amoureux de la lumière aux prises avec ses ténèbres intérieures et d'un pragmatique en peine de son rêve. Car, certes, Van Gogh, vu par Pialat, n'est guère conforme à sa légende. Refusant l'hagiographie, le réalisateur opte pour le portrait d'un artiste à la dérive, d'une tête brûlée qui n'est pas sans similitude avec lui-même. Le peintre refoulé, qu'il est, se retrouve volontiers en cet homme qui croit davantage en la peinture qu'en son talent, qui ne cesse de se heurter aux obligations de la vie, qui ne s'aime pas davantage qu'il n'aime les autres et semble résumer en son seul destin les ambiguïtés et les tragédies de tout créateur. Si bien qu'à travers ce film, Pialat se raconte un peu. N'est-il pas comme son héros un marginal, un révolté, un incompris? Ce qui le captive au premier chef, "est l'éternel combat entre la force de la vie, irruptive, désordonnée, incontrôlable, et la tentation du doute, de l'abandon, de la déchéance" - écrira Serge Toubiana à propos de ce Van Gogh de Pialat. Convergence de vue frappante, si l'on se souvient de la conception du 7e Art que Pialat résumait ainsi : " Il n'y a de réalisme que celui du moment où l'on tourne. Il faut s'approcher le plus près possible de la vérité de l'instant, faite de sentiments très simples. Pour moi, c'est cela la musique d'un film". Ce qui fait l'intérêt particulier de ce long métrage est qu'il ne se contente pas d'être une évocation plus ou moins exacte de la vie du peintre, mais se présente comme une interprétation, par un artiste, du mystère qui entoure la création d'un autre artiste dont il se sent proche à maints égards.
Heureusement quelques scènes réjouissantes viennent égayer cette oeuvre sombre et bouleversante, marquée du sceau de la fatalité - par exemple, l'imitation hilarante de Lautrec par Van Gogh, ou une flânerie dans une guinguette au bord de l'Oise, ou encore un quadrille dans un beuglant. Cette leçon des ténèbres vous prend à la gorge, d'autant que le choix de l'acteur-chanteur Jacques Dutronc pour tenir le rôle de Van Gogh se révèle particulièrement judicieuse. Ce dernier donne au peintre maudit une force, une vérité à couper le souffle. Il est Vincent comme aucun autre acteur ne l'avait été avant lui, le visage creusé, l'air hagard, puis éclatant brusquement dans une gaieté enfantine qui exprime tellement bien, tour à tour, sa part de robustesse et sa part de fragilité ; Pialat nous redessinant de sa caméra-pinceau le visage tourmenté de l'artiste, au point que son image nous hante bien des heures après la projection. Un film dur, âpre, comme le cinéaste les aimait, un film qui laisse longtemps une trace dans la mémoire.
Pour consulter la liste complète des articles de la rubrique CINEMA FRANCAIS, cliquer sur le lien ci-dessous :
LISTE DES FILMS DU CINEMA FRANCAIS







/image%2F0925611%2F20210118%2Fob_0dc858_unnamed-2.jpg)
 VIOLE
VIOLE/image%2F0925611%2F20210118%2Fob_0dc27b_624.jpg)
/image%2F0925611%2F20210118%2Fob_52bb6a_tous-les-matins-du-monde-4.jpg)
/image%2F0925611%2F20210125%2Fob_cb2182_2007-lady-chatterley-de-pascale-ferran.jpg)
/image%2F0925611%2F20210125%2Fob_2dcc3c_lady-c13.jpg)
/image%2F0925611%2F20220529%2Fob_99dcc3_chatterely.jpg)
/image%2F0925611%2F20220529%2Fob_63754f_telechargement.jpg)
/image%2F0925611%2F20210326%2Fob_4a388f_51cr5k5zp9l-ac.jpg)
/image%2F0925611%2F20210326%2Fob_71a77d_voir-et-revoir-les-meilleurs-films-de.jpg)





/image%2F0925611%2F20210403%2Fob_619487_379570.jpg)






/image%2F0925611%2F20210403%2Fob_06429c_b1529fcb-8eeb-42ce-b8dd-ffafd930dbcf-2.jpg)

/image%2F0925611%2F20210313%2Fob_20d8c9_18660220.jpg)

/image%2F0925611%2F20210313%2Fob_16faff_unnamed-1.jpg)
/image%2F0925611%2F20210313%2Fob_0b9118_unehistoiresimple1.jpg)