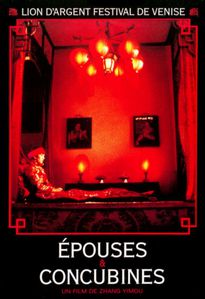En cette époque de l'après-guerre, où des ministres communistes étaient entrés au gouvernement, les cinéastes de gauche s'attachèrent à un cinéma presque exclusivement consacré aux problèmes sociaux, comme ce fut le cas pour Le Chanois, Louis Daquin et Robert Menegoz, veillant à ce que la forme cinématographique soit au service du message, c'est-à-dire du sujet. Cette préoccupation se retrouve chez André Cayatte, qui ne se réclamera pas d'une idéologie de la vérité prolétarienne, ni du néo-réalisme, mais portera son combat sur des faits de société, les problèmes de la culpabilité et les rapports de l'individu avec le système judiciaire. Né en 1909, André Cayatte, licencié ès lettres et docteur en droit, fut d'abord avocat, journaliste, romancier, puis scénariste- dialoguiste sous l'Occupation. Il fait ses débuts de réalisateur avec "La fausse maîtresse" (1942), adaptation libre d'une nouvelle de Balzac, qui sera suivie l'année suivante de "Au bonheur des dames" (1943), d'après Zola et de "Pierre et Jean" (1943) d'après Maupassant. En peu de temps, Cayatte devient un cinéaste populaire, dont les films, sans ambition, plaisent au public qui a besoin de se distraire en ces années difficiles. En 1947 avec "Le dessous des cartes", il produit une affabulation autour de la sombre affaire Stavisky, l'un des scandales politico-policiers de la IIIe République et prend un tournant en 1949 avec "Les Amants de Vérone", version modernisée du Roméo et Juliette de Shakespeare dans l'Italie de l'après-guerre, qui retrace l'histoire d'un amour contrarié par une famille bourgeoise décadente, épave du régime fasciste. Jacques Prévert avait participé à l'adaptation du scénario et écrit les dialogues. Tourné en Italie, on peut y voir une résurgence du réalisme poétique, où la pureté et l'idéalisme des deux héros, interprétés par Anouk Aimée et Serge Reggiani, seront sacrifiés par les forces sociales malfaisantes.
Avec "Justice est faite" (1950) s'ouvre la série de ses films à thèse qui va mériter à leur auteur la notoriété et est destinée à permettre au public de prendre conscience des imperfections de l'appareil judiciaire. L'histoire est celle d'une femme qui accepte de mettre fin aux jours de son amant atteint d'une maladie incurable, afin de lui éviter des souffrances inutiles et pose ainsi le problème de l'euthanasie dans les cas totalement désespérés. Le scénario écrit par Charles Spaak (comme le seront les suivants) se concentrait sur les événements déterminant la positions et le comportement des jurés, le film étant bel et bien construit et mené comme un mélodrame à rebondissements, chargé d'expliquer la difficulté de juger en son âme et conscience un acte criminel où entrent en jeu les sentiments et la morale. Le film fut certes critiqué, les uns considérant que Cayatte se comportait comme un redresseur de torts, mais personne ne put nier l'impact que le film ne manqua pas d'avoir sur les spectateurs, le cinéaste ayant le don des artifices dramatiques et des agencements romanesques. "Justice est faite" reçut d'ailleurs le grand Prix à la Mostra de Venise. En 1952, Cayatte se remet à l'ouvrage et tourne "Nous sommes tous des assassins", vibrant plaidoyer contre la peine de mort. Le Guen, interprété par Mouloudji, après avoir participé à la Résistance, est devenu homme de main et continue, bien que la guerre soit terminée, à user de ses armes pour mener à bien ses crapuleuses actions. Il est jugé et condamné à mort et retrouve en prison trois autres détenus : le docteur Dutoit (Antoine Balpétré) qui a empoisonné sa femme mais le nie, Gino, le Corse, (Raymond Pellegrin) qui a abattu des opposants lors d'une vendetta et Bauchet (Julien Verdier), brute inculte, meurtrier de son propre enfant. Avant de monter à l'échafaud, chacun exposera son cas personnel et, derrière les crimes horribles, se feront jour le manque de racines familiales, la misère, l'ignorance, la promiscuité, car rien n'a changé sous le soleil. Sauf que la peine de mort a été abolie et, qu'en la matière, le film de Cayatte en fut le précurseur à grand renfort de scènes chocs qui produisirent l'effet recherché. Prix spécial du jury au Festival de Cannes, ce long métrage eut une influence considérable sur l'opinion publique. Même ceux qui lui reprochèrent son absence de style - c'est du cinéma oratoire illustré - écrivirent des critiques, hésitèrent à l'attaquer sur le plan des idées. En 1953, "Avant le déluge" sera encore plus contesté. Ce film décrivait avec exactitude la panique qui régnait dans certaines couches de la société à la perspective d'une troisième guerre mondiale et prenait pour intrigue un fait divers authentique : celui d'une bande d'adolescents qui, désirant fuir en Polynésie, n'hésitait pas à commettre des vols afin de se procurer l'argent nécessaire au voyage. Mais voilà qu'un soir, l'affaire avait mal tourné et que les jeunes, dans leur panique, avaient été jusqu'à abattre un gardien de nuit. Le thème, plus compliqué que le précédent, à cause de l'imbrication de plusieurs histoires dans l'histoire, mettait néanmoins en lumière, de façon intéressante, la grande peur suscitée par la guerre de Corée. L'objectif du film était d'étudier les problèmes d'une délinquance juvénile consécutifs au climat que faisaient régner la menace atomique et la guerre froide. Or, dans le souci d'exonérer cette jeunesse d'une part de ses torts, le cinéaste en attribuait la responsabilité aux adultes, à l'égoïsme social et au manque d'éducation, cela jusqu'à la caricature. André Bazin publia dans Les Cahiers du Cinéma, un article qui fit autorité et dans lequel il déplorait un manichéisme outrancier. Les critiques, dans leur ensemble, estimaient que la représentation de la jeunesse et des adultes n'était pas conforme à la réalité et que le cinéaste avait chargé d'une noirceur excessive les personnages, par ailleurs admirablement interprétés par Bernard Blier, Isa Miranda, Paul Frankeur et Antoine Balpétré. Le film n'en remporta pas moins un succès de curiosité et, dans la foulée, Cayatte, en 1955, tourna Le dossier noir qui, une fois encore, mêlait dans un mélodrame habile les rapports de classe, l'étude des moeurs et le suspense psychologique, de manière à convaincre le public de la faiblesse et des tares de la Justice. Le réalisme théâtral, la réalisation emphatique eurent le don d'exacerber l'ironie de François Truffaut qui écrivit : " C'est une chance que Cayatte ne s'attaque pas à la littérature ; il serait capable à l'écran d'acquitter Julien Sorel ; Emma Bovary en serait quitte pour la préventive et le petit Twist irait se faire rééduquer à Savigny".
Est-ce cette presse offensive qui décida momentanément Cayatte à changer son fusil d'épaule ? Toujours est-il qu'en 1958, il offre au public un film émouvant, drame psychologique sur la transformation d'une femme laide par la chirurgie esthétique Le miroir à deux faces, où Bourvil, comme je l'ai écrit déjà, se révélait bouleversant au côté d'une Michèle Morgan belle et diaphane. Nous tenions là, selon moi, le meilleur Cayatte, sobre, efficace. On ne peut nier, par ailleurs, les bonnes intentions de ses autres films qui tous furent à l'origine de débats de société passionnants et rendirent sensibles des dossiers urgents qui, sans eux, auraient peut-être mis plus de temps à se solutionner. Mais le traitement cinématographique de Cayatte, violemment didactique, puis de Yves Ciampi et de Ralph Habib qui lui emboîtèrent le pas, reste malheureusement conforme aux critères commerciaux les plus avérés. Ce qu'il nous faut retenir de ce metteur en scène - il est vrai plus avocat que cinéaste - ce, malgré ses excès, c'est qu'il suivit toujours une pensée directrice et que, pour cette seule raison, il est un auteur du 7e Art. Il mourut à Paris le 6 février 1989, après avoir rédigé 6 romans et réalisé 35 films, dont le très touchant "Mourir d'aimer" (1970), inspiré lui aussi d'un fait divers, qui narrait l'histoire dramatique d'une jeune enseignante amoureuse de l'un de ses élèves et offrait à Annie Girardot, admirable dans ce personnage, l'un de ses rôles les plus poignants.
Pour lire les articles consacrés à Annie Girardot et aux Réalisateurs, cliquer sur leurs titres :
ANNIE GIRARDOT LISTE DES ARTICLES - REALISATEURS du 7e ART
Et pour consulter la liste complète des articles de la rubrique CINEMA FRANCAIS, cliquer sur le lien ci-dessous :
LISTE DES FILMS DU CINEMA FRANCAIS
RETOUR A LA PAGE D'ACCUEIL


/image%2F0925611%2F20210507%2Fob_f4036e_18771790.jpg)



/image%2F0925611%2F20201120%2Fob_7ea3ff_b0222bf1-52bc-4bbb-847d-be1cb9c13c36-2.jpg)
/image%2F0925611%2F20201120%2Fob_92f395_60e3830a7a0f7bb92e083e0f87d821cb.jpg)
/image%2F0925611%2F20210410%2Fob_652cc3_18445289-jpg-r-1280-720-f-jpg-q-x-xxyx.jpg)


/image%2F0925611%2F20210507%2Fob_b59934_18740179.jpg)
/image%2F0925611%2F20210402%2Fob_bc9aff_ebd9d18f-8330-4b37-be36-9b2728650eaf-2.jpg)
/image%2F0925611%2F20210410%2Fob_f87c12_telechargement.jpg)

/image%2F0925611%2F20210406%2Fob_457bb5_18436584.jpg)


/image%2F0925611%2F20210406%2Fob_47d443_18404564-jpg-r-1280-720-f-jpg-q-x-xxyx.jpg)
/image%2F0925611%2F20230417%2Fob_0dafa3_ob-f8de39-hqdefault.jpg)
/image%2F0925611%2F20220608%2Fob_00fa89_simone-signoret-cinepassion34.jpg)

/image%2F0925611%2F20220608%2Fob_c29df3_simone-signoret-harcourt.jpg)