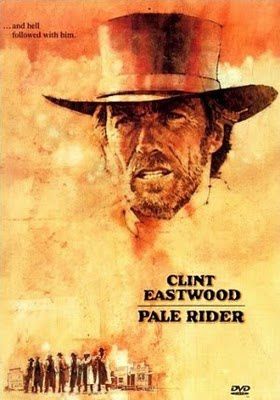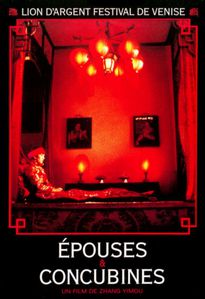Le 30 juin 1957, Ariane (Love in the Afternoon) sort sur les écrans américains. Construite comme un hommage à Ernst Lubitsch, cette comédie marque une étape importante dans la carrière de Billy Wilder. Une étape au cours de laquelle le cinéaste se sépare de son compère Charles Brackett pour entamer une relation de près de trente ans avec I.A.L. Diamond. Mais avant d’évoquer cette collaboration fructueuse, voici un court aperçu du parcours de Billy Wilder. Natif d’une petite ville de Pologne, Wilder suit d’abord une formation de juriste qu'il abandonne rapidement pour devenir journaliste. Il se consacre ensuite à l'écriture de scénarios et travaille pour le célèbre studio allemand U.F.A. jusqu'à la prise de pouvoir du régime nazi. Wilder fuit alors son pays et, après un court séjour en France (où il réalise Mauvaise Graine en 1933 avec Danièle Darrieux), s'installe à Hollywood et vend son premier script. Son talent est rapidement reconnu, ce qui lui vaut d’être associé à Charles Brackett pour l’écriture de La huitième femme de Barbe-Bleue (Ernst Lubitsch, 1938). Les deux hommes s'entendent à merveille, poursuivent leur collaboration et deviennent bientôt les scénaristes les mieux payés d'Hollywood. Adorés des studios et de la profession en général, ils sont nominés à trois reprises aux Oscars pour les scénarios de Ninotchka (1939), La Porte d'or (1941) et Boule de feu (1941). Toutefois, Billy Wilder fait preuve de mécontentement à l’égard du traitement accordé à ses scripts et développe rapidement des velléités de cinéaste. Toujours associé à Brackett dans les phases d’écriture, il démarre sa carrière de metteur en scène en 1942 avec Uniformes et jupons courts. Les deux artistes donnent ensuite naissance à douze films tant sur le registre de la comédie que sur celui du film noir (Assurance sur la mort, La Garçonnière). Puis vient le projet Ariane et la rencontre avec I.A.L. Diamond : de 14 ans son cadet, Diamond est un jeune écrivain dont Wilder a apprécié le travail dans des magazines. Il est également auteur de sketchs dans lesquels sa plume acerbe fait régulièrement mouche. Définitivement séduit par ce talent, Wilder lui propose de devenir son nouveau collaborateur. Les deux hommes s’entendent immédiatement, et tandis que le cinéaste se concentre sur la dramaturgie de son récit, Diamond prend en charge les dialogues. A ses côtés, Wilder orientera son style vers la comédie douce amère et, sans jamais perdre sa causticité, peu à peu se laissera aller vers une certaine forme de romantisme. Le duo signera quelques œuvres souvent jugées irrévérencieuses mais devenues au fil des ans de véritables mètres étalon de la comédie moderne. Parmi ces œuvres, on pense notamment à Certains l’aiment chaud, La Garçonnière, Embrasse-moi, idiot et donc... Ariane.
Ariane est l’adaptation d’un roman de Claude Anet (Ariane, jeune fille russe) dans lequel la jeune héroïne entretient une relation passionnelle avec un homme d’âge mûr. Ce pitch est l’occasion pour Wilder et Diamond de dresser un portrait au vitriol du mâle américain et de dénoncer l’aliénation de l’individu dans la société moderne. Ici, l’individu en question n’est autre qu’Ariane, à la fois soumise à l’autorité paternelle et à celle de son amant. Afin de se défaire de cette double emprise, elle utilisera le mensonge, jouera sur les apparences et devra faire preuve de beaucoup de malice. La voir ainsi manipuler Flanagan, ce riche industriel blasé des histoires d’amour, est un véritable plaisir pour le spectateur. Peu à peu, le récit montre comment les rôles s’inversent (la jeune innocente devient manipulatrice, tandis que le vieux séducteur retrouve des émotions d’adolescent) jusqu’à trouver un équilibre qui les verra finalement se dévoiler avec franchise. Doté d’un charme de tous les instants, ce scénario diffuse un discours délicieusement acerbe et ponctué de dialogues absolument exquis. Citons par exemple Monsieur Chavasse, révélant une nouvelle affaire à sa fille : « A client from Brussels. His wife ran away to Paris with the chauffeur. I have to find them ; the husband wants his car back. » Ou encore la fameuse introduction du film pendant laquelle le narrateur explique : « In Paris people eat better, and in Paris people make love, well, perhaps not better, but certainly more often. » Enfin, terminons par cette petite pique de Wilder à l’encontre des Américains lorsqu’Ariane les décrit à son ami : « They're very odd people, you know. When they're young, they have their teeth straightened, their tonsils taken out and gallons of vitamins pumped into them. Something happens to their insides ! They become immunized, mechanized, air-conditioned and hydromatic. I'm not even sure whether he has a heart. »


Mais dramaturgie et dialogues ne suffisent évidemment pas à expliquer le charme envoûtant d’Ariane. Un film qui, tel d’un bon vin, se bonifie au fur à mesure des dégustations. Car pour l’apprécier pleinement, il faut procéder à l'instar de son héroïne avec son amant : après une première rencontre pleine de charme, il est conseillé de répéter l'expérience. Une première fois, une deuxième, une troisième puis encore et encore jusqu'à tomber éperdument amoureux de cette œuvre intelligente et aux multiples facettes. Nul doute que certains critiques de l’époque n’ont pas pris ce temps et ont rédigé leurs papiers assassins à l’emporte-pièce.


Avec Ariane, Billy Wilder fait pourtant preuve d'ambition et de maîtrise en adoptant un style marqué par les années 30/40, un style proche de celui d'Ernst Lubitsch. Il choisit notamment de tourner en noir et blanc et s'attache les services de William C. Mellor, directeur photo couronné d'un Oscar en 1952 pour Une place au soleil (George Stevens). Le regard empreint de douceur qu’il pose sur les décors imaginés par Alexandre Trauner, combiné à la simplicité des mouvements d’appareil de Wilder, concourent à donner au spectateur l’impression d’un film tourné en plein âge d’or.
Mais l’hommage à Lubitsch ne se limite pas à une mise en image nostalgique de cette période faste. Il instille dans son écriture et sa mise en scène un comique de répétition parfaitement orchestré : dans l'hôtel, Flanagan reçoit régulièrement ses conquêtes selon un protocole réglé au millimètre. Et si les situations se répètent, elles ne provoquent jamais le moindre ennui car toujours rythmées par des gags récurrents et souvent hilarants. Citons, par exemple, ceux provoqués par ce petit chien sans cesse puni pour des bêtises qu’il n’a pas commises ou encore les allers et venues d'un orchestre de Gitans muets. Cet orchestre dont tous les amoureux d’Ariane se souviennent avec nostalgie, donne au film un ton résolument musical et marqué par quelques belles compositions. Comment ne pas évoquer l’excellente utilisation de Fascination, thème amoureux devenu depuis un véritable standard. Une mélodie simple et entraînante dont le spectateur a bien du mal à se détacher après la projection...
Continuons, car la filiation entre Ariane et les films de Lubitsch ne s'arrête pas là ! En choisissant Gary Cooper pour interpréter Flanagan, Billy Wilder fait un pas de plus vers le cinéma de son mentor. Néanmoins, rappelons que Cooper n'était pas le premier choix de Wilder. Le cinéaste rêvait depuis longtemps de diriger Cary Grant. Il lui avait notamment proposé le premier rôle de Sabrina que Grant avait refusé au profit de Bogart. Tenace, Wilder revient donc à la charge pour Ariane et lui offre d’interpréter Flanagan. Dans un premier temps, Grant accepte mais lorsqu'il apprend qu'il devra donner la réplique à Audrey Hepburn, il abandonne le projet. La différence d'âge lui paraît trop exagérée, il ne croit pas à cette histoire d'amour. Wilder accuse le coup et se tourne vers Yul Brynner. C'est à nouveau un refus et vient alors l'idée de Cooper : âgé de 56 ans, Cooper est l'incarnation même du mâle américain des années 30/40. Et de surcroit, il est l'acteur "lubitschien" par excellence ! Dans Ariane, il incarne un riche industriel. Séducteur de tous les instants, son personnage évoque celui de Linus Larrabee (Humphrey Bogart) dans Sabrina. Mais il fait également référence au héros de La huitaine femme de Barbe-Bleue. Sous l'œil de Wilder, Cooper endosse le rôle d'un séducteur pris à son propre piège. On le voit aux bras de nombreuses jeunes femmes, les journaux ne cessent de relater ses aventures amoureuses jusqu’à sa rencontre avec Ariane. Pour donner corps à ce rôle, Gary Cooper use de son charme légendaire et impose une sorte de force tranquille. Certains critiques reprocheront sa présence en tête d’affiche, le jugeant trop âgé et non crédible dans son rôle de tombeur. Mais il paraît bien mesquin de réduire la critique d’un film à un tel argument. Comme le montre le récit, l'histoire d'Ariane et sa passion pour les potins mondains ont forgé en elle une fascination pour des personnalités comme celle de Flanagan. Dès lors, il n'est guère surprenant de la voir tomber dans les bras de cet Américain au regard ravageur et bâti comme un cow-boy !
Aux côtés de Gary Cooper, Billy Wilder offre le rôle de Monsieur Chavasse à Maurice Chevalier. Ici encore, il est évident qu'un tel choix n'est pas uniquement le fruit d'une réflexion sur les qualités d'acteur de Chevalier ! Digne représentant de Lubitsch, qui l'a dirigé dans Parade d'amour (1929) ou La Veuve joyeuse (1934), le comédien était l'archétype même du "French Lover". Devant la caméra de Wilder, il incarne le père d'Ariane : un homme affable, doux et malin, qui donne son tempo au film. Narrateur, il est celui dont la voix introduit le récit. Sur ce point, il est d'ailleurs amusant de comparer Ariane avec Gigi. Tourné un an plus tard, le film de Minnelli démarre exactement comme Ariane. Au cours d'un long monologue, Maurice Chevalier évoque Paris et ceux qui s'aiment avec le charme désuet de son accent français. Difficile de dire si Vincente Minnelli s'est inspiré de la mise en scène de Wilder mais l'analogie est frappante...

Enfin le triangle des personnages ne saurait être complet sans la présence d'Audrey Hepburn. Habillée par Givenchy, elle promène sa silhouette légendaire sous le regard amusé de Billy Wilder. Totalement sous son charme, le cinéaste semble avoir façonné son film comme un écrin pour l'y accueillir. Peu de temps après le tournage, Wilder jouera au prophète en affirmant : «Le culte du néné a envahi le pays. Audrey Hepburn peut d'un revers de main envoyer les grosses poitrines au grenier. Plus jamais un réalisateur ne devra inventer des plans où la fille se penche en avant pour prendre un scotch ou un soda. » Si la déclaration est jolie, rappelons tout de même que, deux ans plus tard, Wilder retournera au "grenier" pour y retrouver Marylin Monroe avec qui il tournera Certains l'aiment chaud !


Audrey Hepburn, Gary Cooper et Maurice Chevalier forment donc le trio d'Ariane. Trois comédiens qui, sous l'œil acéré de Wilder, donnent vie à un scénario cousu main. Avec ce film, Billy Wilder réalise certainement son œuvre la plus "lubitschienne". Une manière pour lui de rendre hommage à son mentor tout en offrant à son public une comédie à la fois douce et impertinente avec des acteurs inoubliables.
Pour prendre connaissance des articles de la rubrique CINEMA AMERICAIN et CANADIEN, cliquer sur le lien ci-dessous :
LISTE DES FILMS DU CINEMA AMERICAIN ET CANADIEN
RETOUR A LA PAGE D'ACCUEIL







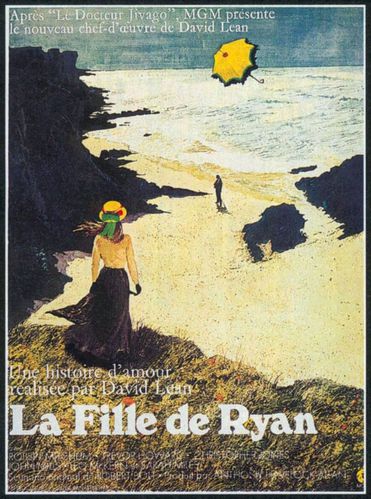







/image%2F0925611%2F20210317%2Fob_17eeba_blue-jasmine-ver2.jpg)
/image%2F0925611%2F20210317%2Fob_3fab05_1374784619000-ap-film-review-blue-jasm.jpg)
/image%2F0925611%2F20210317%2Fob_27e89a_3478539-6-9401-cate-blanchett-dans-le.jpg)
/image%2F0925611%2F20210317%2Fob_b563ea_bluejasmine1.jpg)